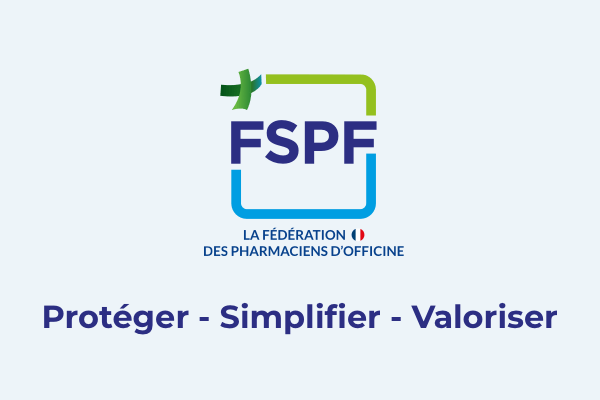Qu’est-ce que le CEIP-A et quelles sont ses missions ?
Le Centre d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance-addictovigilance est une structure de veille sanitaire des substances psychoactives sous tutelle de l’ARS et de l’ANSM. Il est compétent pour toutes les drogues illicites, mais aussi pour les médicaments. Les drogues non interdites ou non réglementées (poppers, protoxyde d’azote…), ainsi que les plantes psychoactives entrent également dans son champ d’action. Nous surveillons les complications liées à leur usage, nous évaluons le potentiel d’abus et de dépendance et émettons des recommandations. Nous conduisons enfin des travaux de recherche scientifique et avons également des missions d’appui et d’expertise avec la constitution régulière de rapports pour dresser, par exemple, un état des lieux du détournement d’une substance. Grâce au réseau des 13 CEIP-A répartis sur le territoire national, nous parvenons à obtenir une photographie globale des pratiques. Il faut noter que l’addictovigilance est une spécialité française, pensée dès le départ comme une vigilance d’investigation.
Quelles sont vos sources d’information ?
Il peut s’agir de signalements spontanés via un appel ou un formulaire rempli par un professionnel de santé comme un pharmacien, qui nous remonte des ordonnances frauduleuses ou qui constate une augmentation anormale des ventes d’un produit hors prescription. Cela peut également être un patient qui nous rapporte qu’il a perdu le contrôle vis-à-vis de son traitement. Si la démarche semble plus complexe qu’en pharmacovigilance, elle ne devrait pas l’être puisqu’une pharmacodépendance est un effet indésirable comme un autre et l’on ne doit pas mettre de tabou dessus. Mais la difficulté persistante à parler de dépendance nous oblige à mener nos propres investigations sous forme d’enquêtes annuelles afin de constituer un état des lieux. L’enquête Osiap, par exemple, se concentre sur les ordonnances suspectes indicatrices d’abus possibles. Oppidum, elle, permet d’être au fait des usages et des tendances chez les usagers de produits psychotropes. Nous centralisons ces informations et les relayons aux autorités afin qu’elles prennent les mesures adéquates de préservation de la santé publique.
Vous êtes le rapporteur national de l’enquête « Soumission chimique ». Que recoupe ce phénomène ?
C’est le fait de droguer une personne à son insu ou sous la menace pour commettre un crime ou un délit. Elle est à distinguer d’une autre agression facilitée par les drogues, la vulnérabilité chimique, qui est le fait d’avoir consommé soi-même une substance qui nous a mis dans un état de fragilité et nous a rendu plus vulnérable à une agression. Dans les deux cas, c’est très grave. Au regard de la loi, ce sont d’ailleurs des facteurs aggravants. C’est en 1997 que les autorités sanitaires ont demandé un état des lieux de l’usage criminel des drogues qui a révélé que les benzodiazépines pouvaient être utilisées à des fins criminelles. On parlait alors de soumission médicamenteuse. Cette enquête nationale a fini par être institutionnalisée en 2003 et fait désormais l’objet de rapports annuels d’expertises ce qui est, encore une fois, unique au monde.
Combien d’actes délictueux sont-ils recensés ?
Dans le dernier rapport en date, celui de 2021, 727 cas nous ont été notifiés. Le croisement des données cliniques et toxicologiques permet ensuite de dire s’il s’agissait de cas de soumission chimique parce qu’une substance suspecte a été identifiée, qui n’est pas déclarée consommée par la victime et qui n’est pas retrouvée en antériorité, par exemple dans ses cheveux.
« Une pharmacodépendance est un effet indésirable comme un autre. »
L’évaluation finale a mis en exergue 10 % des cas correspondant à des soumissions chimiques vraisemblables. Mais il ne faut pas oublier que dans les cas de violences sexuelles, pour ne parler que de celles-là, moins de 10 % des victimes déposent plainte et que, très souvent, l’agresseur est connu : il est extrêmement difficile de porter plainte contre son patron, son ami, son père. De plus, si la personne a consommé elle-même des substances psychoactives, elle éprouve systématiquement une culpabilité qui n’a rien à faire là. Pour de multiples raisons, il est donc très difficile de chiffrer ce phénomène.
Quelles sont actuellement les substances les plus impliquées ?
Elles sont très variables mais c’est majoritairement le médicament psychoactif qui est retrouvé. Essentiellement des sédatifs (benzodiazépines, antihistaminiques, neuroleptiques, opioïdes…) dans le but d’endormir, de fatiguer, de faire baisser la vigilance. Ces produits ne viennent pas forcément d’un trafic : l’armoire à pharmacie familiale ou celle d’une personne malade ou âgée de l’entourage peut suffire. Mais alors qu’en 2020, 73 % des mentions concernaient les médicaments, l’écart avec les drogues se réduit. Ces dernières peuvent être également employées à des fins sédatives, mais aussi pour des propriétés stimulantes (MDMA) ou dissociatives (kétamine). L’objectif est alors de désinhiber, d’altérer le comportement et le discernement ou de faire quitter la notion de la réalité. On a en effet tendance à penser que la bonne victime de soumission chimique est la victime endormie. Or, on peut être parfaitement actif sans pour autant être en possession de soi-même.
Existe-t-il des profils type des victimes ?
Une majorité de femmes et de personnes de 20-29 ans sont retrouvées dans nos données. Je ne veux pas invisibiliser ces tendances car elles existent. Mais il ne faut surtout pas s’arrêter à ça. Les victimes n’ont en réalité pas de profil spécifique, ce sont des femmes, mais ce sont également des hommes, des personnes transgenres, de tout niveau social et de toute orientation sexuelle. Pour les femmes, comme pour les hommes, l’agression subie la plus fréquente est l’agression sexuelle. On entend souvent qu’il n’est pas très prudent de rentrer seule la nuit quand on est une femme. Mais ça ne l’est pas non plus quand on est un homme. Il n’y a également pas d’âge pour être victime d’une soumission chimique, même si les âges extrêmes de la vie sont très représentés dans les cas de maltraitance chimique. Globalement, il y a autant d’affaires que de profils de victimes et de crimes commis.
« Le domicile est le lieu de prédilection pour droguer quelqu’un à son insu. »
L’agression sexuelle est majoritaire, mais la soumission chimique concerne aussi des vols, des règlements de compte, des enlèvements, des séquestrations, des homicides… Schématiquement, on peut distinguer trois cas. La victime qui sait qu’on la drogue puisqu’on l’oblige à prendre la substance, celle qui va s’en douter parce qu’elle s’endort et se réveille dans un autre endroit, nue ou habillée différemment, avec des écoulements… Et puis il y a celle, très rare, qui s’ignore totalement du fait de l’amnésie et de l’absence de conjugopathie par exemple. C’est la fameuse affaire du Vaucluse qui est un cas d’école en la matière : on ressent des symptômes étranges, on fait le tour des médecins qui concluent à une somatisation. Il est ici primordial de dire qu’il ne faut pas exclure l’hypothèse d’une soumission chimique quand rien n’explique l’état d’une personne. Mais de manière générale, les victimes ne sont pas dupes. J’en ai un peu assez d’entendre qu’elles s’ignorent alors qu’elles nous décrivent très bien les modes opératoires, en rapportant par exemple que leurs troubles débutent toujours au même moment de la journée ou dans les mêmes circonstances.
Où se déroulent principalement les faits ?
On parle souvent du contexte festif qui est une réalité, mais la soumission chimique est aussi très présente dans la sphère privée : le domicile est le lieu de prédilection pour droguer quelqu’un à son insu. Il y a une spécificité de la soumission chimique dans la sphère intrafamiliale car elle est très souvent chronique. L’impression que c’est forcément dans la boisson alcoolisée que l’on va vous droguer est fausse. Cela peut être dans le petit-déjeuner ou dans le yaourt du soir. Il ne faut pas non plus oublier les prises forcées. Les femmes battues rapportent ainsi qu’on peut les obliger à boire de l’alcool, à sniffer de la cocaïne, etc. Parce que cela fait partie de la maltraitance, du continuum de la violence. Parfois, l’usage de substances dans une famille peut être le symptôme de violences conjugales – des hommes drogués à leur insu par leurs femmes battues – ou des indicateurs d’inceste : une compagne droguée pour mieux abuser les enfants quand elle dort.
Quelle est la conduite à tenir à l’officine devant une victime potentielle ?
Il est très compliqué de gérer ce type de situation au comptoir. Cependant, il est important de montrer à la victime que la pharmacie est un refuge pour elle, que l’équipe sait de quoi elle parle parce qu’on sait que cela existe et qu’on peut l’aider. L’idée est bien sûr de l’orienter vers les structures qui peuvent lui venir en aide. Mais attention : il est fondamental de respecter le consentement d’une personne majeure qui ne souhaite pas déposer plainte, même s’il faut toujours encourager la judiciarisation. De même qu’il ne faut pas appeler son médecin sans son accord. C’est en revanche totalement différent quand on parle d’un mineur ou d’un senior dément, vulnérable ou d’une personne en situation de handicap. Une chose à faire est également de repositionner la culpabilité où elle doit être, c’est-à-dire du côté de l’agresseur, quand bien même la victime aurait consommé des substances de son propre chef. Et puis, en tant que pharmacien, il faut évidemment se préoccuper du volet sanitaire. Délivrer si nécessaire une contraception d’urgence et orienter vers un Cegidd ou les urgences pour l’administration d’une prophylaxie post-exposition. Dans tous les cas, on peut diriger la personne vers le centre d’addictovigilance qui saura quelles démarches engager et quels professionnels contacter : nous sommes là également pour ça, sur simple appel téléphonique. Si le pharmacien d’officine est un acteur majeur de la vie quotidienne des gens, il a un également un rôle non négligeable à jouer dans le cadre de ces violences.