Accueil / Santé / International / Aux frontières de la mort
De récentes études apportent un éclairage nouveau sur le moment où la vie s’éteint. Un espoir pour de futurs traitements neuroprotecteurs et protocoles améliorés en réanimation.
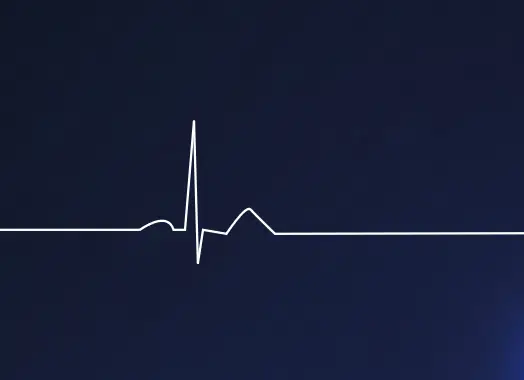
🇫🇷 France
INFLAMMATION ET COMA
Une étude de médecins du CHU de Toulouse (France) et de chercheurs de l’Inserm, publiée dans Brain le 27 février 2024, a réussi à caractériser l’inflammation cérébrale de patients dans le coma grâce à l’imagerie TEP-scan. L’échantillon est modeste (17 malades) mais les perspectives immenses. Les clichés de patients, tous hospitalisés en réanimation au CHU de Toulouse entre 2018 et 2022, ont été comparés avec ceux de sujets sains. « C’est une première in vivo qui a permis d’évaluer la présence, la localisation et l’intensité de l’inflammation, explique le Pr Stein Silva, médecin réanimateur, chercheur au sein de l’unité Tonic de l’Inserm et investigateur principal de l’étude. Cela augure d’un véritable changement de paradigme dans la prise en charge du coma et les perspectives de pronostic de récupération des patients. » Les chercheurs ont utilisé un radiotraceur et pu constater que chez les patients dans le coma à la suite d’une anoxie, l’inflammation très intense est localisée dans des régions clés pour l’état de conscience (les noyaux gris du cerveau et le cortex cingulaire postérieur), alors que chez ceux en état post-traumatique, elle se situe dans le cortex préfrontal, de manière plus diffuse. « Voilà qui ouvre la voie à des stratégies thérapeutiques, ce qui
était inenvisageable tant que l’on n’avait pas identifié ni localisé l’inflammation », avance une des auteurs. Autre enseignement majeur : « Les patients qui ont le cerveau le plus enflammé sont ceux qui ont le plus mauvais pronostic de réveil. Nous ouvrons de nouvelles pistes de recherche », conclut le Pr Silva
🇫🇷 France
OURSONS IMMORTELS
Du haut de son unique millimètre et avec son look bizarre d’« ourson d’eau », le tardigrade est capable de résister au vide spatial, à des températures de l’ordre de – 273° C, des pressions quatre fois supérieures à celles des abysses, des radiations démentielles… Mais cet « extrémophile » a besoin d’eau pour être actif et entre en cryptobiose dès qu’elle vient à manquer : il réduit alors son métabolisme jusqu’à un seuil quasi indétectable avant de se réveiller, parfois plusieurs décennies plus tard, dès qu’il est réhydraté. Des chercheurs américains viennent d’expliquer, le 17 janvier 2024 dans Plos One, quel mécanisme précis induit cette dormance. Ils ont poussé à bout la pauvre bestiole pour voir comment elle réagissait à des températures glaciales, des niveaux délirants de sucre, de sel ou encore de peroxyde d’hydrogène. « En réponse à ces conditions nocives, les cellules des ours d’eau ont produit des radicaux libres oxygénés. » Ces derniers oxydent ainsi un acide aminé, la cystéine, qui fait office de capteur pour que l’ordre soit donné aux cellules du tardigrade d’entrer en cryptobiose. « Une fois les conditions améliorées et les radicaux libres disparus, le capteur n’est plus oxydé et les oursons d’eau sortent de leur dormance. » De vraies Belles au bois dormant, le sex appeal en moins !
🇺🇸 États-Unis
DES BIPS POTENTIELLEMENT MORTELS
Les alarmes hospitalières sont une question de vie ou de mort. Mais lorsqu’elles se déclenchent de manière incessante, les soignants peuvent subir une vraie fatigue susceptible d’altérer les soins. Des données de la FDA ont ainsi estimé que cette lassitude, poussant certains à éteindre les alarmes et oublier de les rebrancher, était responsable de la mort de 566 patients sur cinq ans, entre janvier 2005 et juin 2010. En 2015, une
étude nord-américaine a évalué que les soignants hospitaliers percevaient en moyenne un millier de bips par jour, dont seulement 15 % étaient jugés importants. Cette même année, Joseph Schlesinger, un anesthésiste du centre médical de l’Université Vanderbilt à Nashville (États-Unis), et Michael Schutz, un chercheur en cognition musicale de l’Université McMaster à Hamilton (Canada), ont examiné des sons plus doux capables de capter l’attention des soignants occupés. Ils ont découvert que le timbre « percussif », comme le tintement de deux verres de vin qui s’entrechoquent, ressort même à faible volume. Des tonalités fortes et plates, comme le bip d’un camion en marche arrière, sont quant à elles perdues. Les deux hommes ont publié, en septembre 2023 dans Perioperative Care and Opening Room Management, une étude embarquant 42 participants âgés de 17 à 23 ans dont les conclusions sont édifiantes : « Nos résultats révèlent que les alarmes sonores musicales sont comparables, mais nettement moins gênantes que les signaux d’alarme courants dans les environnements médicaux. Ils constituent une première étape prometteuse pour améliorer les soins aux patients grâce à une conception d’alarme éclairée par la musique. »
🇺🇸 États-Unis
CONVULSIONS AVANT MORT SUBITE
Des chercheurs de la New York University (NYU) Grossman School of Medicine (États-Unis) ont publié le 13 février 2024 dans Neurology une étude suggérant que de brèves crises convulsives pourraient être à l’origine de décès subits inexpliqués de nourrissons. Les scientifiques se sont basés sur un registre de plus de 300 cas de morts subites inexpliquées chez les enfants (SUDC) et ont décortiqué les dossiers médicaux ainsi que les vidéos, fournies par les familles, de la dernière période de sommeil de sept enfants âgés de 1 à 3 ans.
L’autopsie réalisée sur ces derniers n’avait révélé aucune cause spécifique de décès, et un seul d’entre eux avait des antécédents de convulsions fébriles. Les enregistrements ont révélé des crises convulsives de moins de 60 secondes se produisant dans les 30 minutes précédant le décès de chaque enfant. Des recherches antérieures avaient déjà montré que les enfants décédés subitement et de manière inexpliquée étaient dix fois plus susceptibles d’avoir eu des convulsions fébriles que les autres, et de tels événements étaient notifiés dans un tiers des cas de morts similaires enregistrées à la NYU Langone Health. Cette étude, bien que portant sur une petite cohorte, apporte la première preuve directe que les convulsions pourraient être responsables de certaines morts subites chez les enfants, soulignant l’importance d’investigations supplémentaires pour déterminer la fréquence des crises convulsives durant le sommeil des tout- petits, mais aussi des enfants plus âgés et des adultes avant ce type de décès.
🇫🇷 France
L’ONDE DE LA MORT LIVRE SES SECRETS
Des chercheurs de l’Institut du Cerveau (ICM) de l’Inserm à Paris (France) ont identifié, dans le cortex somatosensoriel primaire de rats, « l’onde de la mort ». En explorant les profondeurs de l’activité cérébrale au moment du trépas, ils ont observé pour la première fois une onde spécifique qui survient lors de la non-oxygénation prolongée du cerveau et révèle une complexité insoupçonnée dans la dynamique neuronale entre la vie et la mort. Ainsi, pour Stéphane Charpier, l’un des auteurs de l’étude publiée dans Neurobiology of Disease en novembre 2023, « il n’y a pas d’instant zéro de la mort ».
L’arrêt de l’oxygénation du cerveau enclenche une série d’événements qui commence par une réduction drastique de l’activité électrique, brusquement interrompue par une onde de grande amplitude, initiée dans les couches profondes du cortex (certainement ce qui est décrit dans les « near death experiences »). Les chercheurs expliquent qu’elle se diffuse dans le cortex telle une vague, portant en elle le potentiel d’une cessation totale de l’activité cérébrale. Mais contrairement à ce que son nom suggère, elle ne signifie pas nécessairement une fin irréversible : si le cerveau est réoxygéné à temps, une « onde de la réanimation » peut suivre, marquant le début d’une lente mais possible récupération des fonctions cérébrales ! Ces découvertes importantes laissent espérer le développement de traitements neuroprotecteurs et permettent d’envisager que les pratiques de réanimation en cas d’arrêt cardiorespiratoire puissent un jour être transformées, réduisant les risques de séquelles neurologiques et ouvrant la porte à des interventions plus ciblées pour préserver les fonctions cérébrales essentielles.
Vous êtes déjà abonné ?
Connectez-vous pour mettre à jour vos identifiants :
Vous n’êtes pas encore abonné ?
Rejoignez-nous !