Accueil / Santé / International / Trier le bon gras de l’ivraie
Difficile de lui résister tant il est appétent, au point d’activer les mêmes zones cérébrales que la cocaïne. Le gras peut se montrer sournois jusqu’à infiltrer les poumons, mais parfoisil peut aussi nous vouloir du bien !
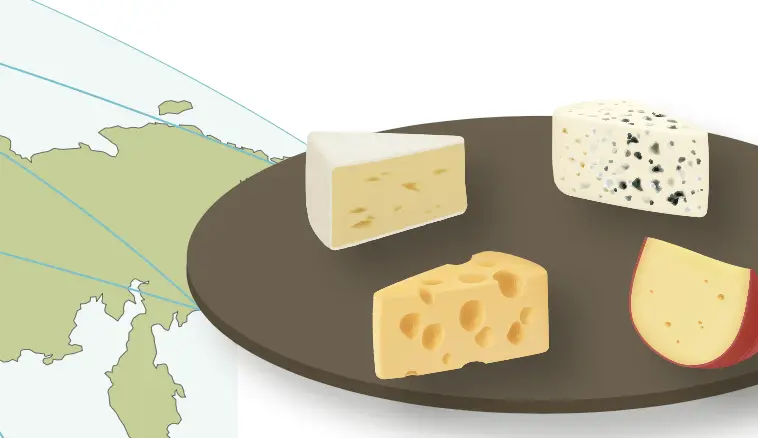
🇫🇷 France
En manque de burger ?
La junk food peut-elle faire l’objet d’une toxicomanie ? Si l’on aurait tendance à répondre par l’affirmative, encore faut-il le prouver scientifiquement. C’est ce que s’est attaché à faire une équipe franco-américaine, par une étude publiée le 19 décembre 2022 dans Nature Neurosciences. Bien que l’ingestion d’un hamburger soit bien capable de provoquer la sécrétion de dopamine, des travaux récents ont montré que le potentiel addictif des aliments ultratransformés n’est pas seulement lié à cette dernière mais également à l’importance du récepteur cannabinoïde 2 (CB2). Une équipe barcelonaise a ainsi pu montrer que des souris dont le cerveau était dépourvu de récepteurs CB2 étaient moins enclines que des rongeurs « normaux » à devenir dépendantes, non seulement à la cocaïne et à l’alcool, mais aussi à des boulettes aromatisées au chocolat. L’étude de Nature Neurosciences dirigée par Léonie Koban de l’Institut du cerveau (ICM) à Paris montre quant à elle, imagerie cérébrale à la clé, que ce sont les mêmes zones de l’encéphale qui s’activent lorsque l’on présente à des cocaïnomanes des images de leur drogue et à des personnes qui ne consomment pas de drogues des photos de… beignets. Et plus l’envie des participants est forte, plus les réactions neuronales s’avèrent intenses. Les chercheurs ont ainsi identifié un neuromarqueur du craving, ce besoin irrépressible de consommation d’un produit psychoactif, qu’ils ont nommé « signature biologique de l’envie » (NCS), et qui peut donc s’activer face à une représentation de drogue dure comme devant une image de pâtisserie grasse et sucrée.
🇫🇷 France
Le foie gras aussi pour les minces
Les cas de stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD), plus connue du grand public sous l’acronyme NASH, et récemment rebaptisée maladie stéatosique hépatique associée à un dysfonctionnement métabolique (MASLD), augmentent dans le monde. Elle est présente chez 25 à 45 % des patients atteints d’un syndrome métabolique, mais également chez 8 à 19 % des personnes minces ! Une étude publiée par des chercheurs français dans Hepatology le 1er juillet 2023 a voulu comparer, sur la cohorte nationale Constances de 169 303 participants scrutés entre 2012 et 2017, les caractéristiques des sujets avec MASLD et la mortalité entre les participants minces et ceux en surpoids ou obèses. La prévalence de la maladie était de 5,3 % chez les sujets minces mais 16,3 % des sujets atteints de MASLD répondaient au critère de minceur. Or, il s’est avéré que malgré leur meilleur profil métabolique, la prévalence de la fibrose avancée était significativement plus élevée chez les sujets minces (3,7 % contre 1,7 %).
Conclusion des auteurs : « Cette étude dans une grande cohorte communautaire confirme que la MASLD chez les sujets maigres est plus sévère pour la fibrose, la progression de la maladie du foie, l’insuffisance rénale et la mortalité globale. » Parmi les causes évoquées, une moins bonne hygiène alimentaire et une consommation modérée d’alcool et de tabac, dont la prévalence aurait augmenté en France durant la période de suivi de cette cohorte, sont suggérées. De futures études prospectives pourront apporter une meilleure compréhension de la stéatopathie et de son évolution défavorable chez les sujets minces.
🇩🇪 Allemagne
Cerveau modifié
Chacun sait que certains aliments sont plus sains que d’autres. Mais lorsqu’il s’agit de renoncer à un brownie pour une pomme, c’est une autre affaire. Des chercheurs allemands ont publié le 4 avril 2023 dans Cell Metabolism une étude visant à expliquer pourquoi le gras et le sucre sont si irrésistibles. Il est déjà démontré que l’exposition au gras et au sucre agit sur les circuits de la récompense et que l’obésité s’accompagne d’une altération de la fonction dopaminergique dans le cerveau. Mais toute la question était de savoir si les personnes obèses avaient une fonction dopaminergique défaillante avant d’être en surpoids ou si elle s’altérait au fur et à mesure de l’exposition au gras et au sucre ainsi que de la prise pondérale. Pour savoir laquelle des deux hypothèses était la bonne, les chercheurs ont conduit une étude randomisée auprès de participants en bonne santé et de poids normal. Pendant huit semaines, certains recevaient une collation grasse et sucrée en complément de leur régime habituel et d’autres un en-cas faible en matières grasses et sucrées. Au final, c’est bien la deuxième hypothèse qui s’est vérifiée : chez les personnes de poids normal et en bonne santé, « la préférence pour les aliments faibles en gras diminue tandis que la réponse du cerveau au milkshake augmente », notent de façon on ne peut plus claire les chercheurs.
🇦🇺 Australie
Poumon gras
Des études épidémiologiques rapportent que les asthmatiques en surpoids ou obèses présentent une maladie plus grave que ceux ayant un poids de forme. Or, des chercheurs australiens ayant
eu la possibilité d’observer des poumons de patients ayant donné leur corps à la science ont fait une découverte inédite qui pourrait expliquer cette plus grande gravité de l’asthme en corrélation avec
un IMC élevé. Ils ont ainsi retrouvé davantage de graisse dans les poumons des personnes en surpoids ou obèses souffrant de maladies respiratoires que chez les autres. Jusqu’alors, la communauté scientifique savait que le risque de maladies respiratoires était accru en cas de surpoids, mais c’est la première fois que de la graisse est découverte à l’intérieur des poumons de patients atteints de ces pathologies. Le Pr Thierry Troosters, président de la Société européenne de
pneumologie, a réagi à ces travaux publiés en septembre 2019 dans l’European Respiratory Journal : « Il s’agit d’une conclusion importante sur la relation entre le poids corporel et les maladies respiratoires car elle montre comment l’excès de poids ou l’obésité pourrait aggraver les symptômes chez les personnes souffrant d’asthme. Cela va au-delà de la simple observation selon laquelle les patients atteints d’obésité ont besoin de mieux respirer avec l’activité et l’exercice,
ce qui alourdit leur charge ventilatoire. »
🇯🇵 Japon
Du fromage pour rester fringuant
Certes, ces travaux ont été menés au Japon, connu pour offrir l’un des meilleurs régimes alimentaires de la planète conjointement avec la diète méditerranéenne. Mais elle est suffisamment significative – et réjouissante pour les fondus du fromage – pour être mise en avant ! Cette étude transversale, menée sur 1 503 personnes âgées de plus de 65 ans, a cherché à savoir si la consommation de fromage était délétère ou protectrice pour le cerveau. Les participants ont passé une batterie de tests visant à évaluer leurs fonctions cognitives après avoir été copieusement cuisinés sur la fréquence de leur consommation de fromage, lait, poisson, viande, œufs, soja, pommes de terre, fruits, algues, légumes, graisses et huiles, ainsi que sur leurs éventuelles maladies chroniques (cardiaque, hyperlipidémie, dyslipidémie, diabète, ostéoporose, arthrose ou anémie). L’étude, publiée dans la revue Nutrients
le 18 juillet 2023, fait apparaître une corrélation significative : plus les personnes ont mangé de fromage, meilleur est leur score cognitif. Reste à savoir pourquoi. « Une analyse longitudinale à grande échelle est nécessaire pour élucider la relation de cause à effet », concluent les auteurs. Mais ils avancent des pistes : les personnes friandes de fromage semblent globalement présenter un régime plus varié. Or, des travaux antérieurs ont associé une grande diversité alimentaire à une meilleure fonction cognitive. Cependant, ajoutent-ils, des analyses complexes des paramètres de l’étude montrent que « le score de variété alimentaire n’était pas considéré comme une variable indépendante significative pour la fonction cognitive, ce qui indique que la possibilité que le fromage contienne des nutriments spécifiques qui soutiennent la fonction cognitive ne peut être niée ».
Vous êtes déjà abonné ?
Connectez-vous pour mettre à jour vos identifiants :
Vous n’êtes pas encore abonné ?
Rejoignez-nous !